
Savoir-pouvoir : du "livre sur les signes" au "livre sur les peines"
Nous avons vu dans un premier temps la perspective nouvelle que Foucault propose avec son archéologie du savoir qui consiste à sonder le sol d'une civilisation à une époque donnée : loin des débats universitaires, cette approche nous intéresse car elle rompt avec l'humanisme ambiant et " toutes ces entreprises bavardes ", " tous ces cris du cœur, toutes ces revendications de la personne humaine, de l'existence, sont abstraites: c'est-à-dire coupées du monde scientifique et technique qui, lui, est notre monde réel. Ce qui me fâche contre l'humanisme, explique Foucault c'est qu'il est désormais ce paravent derrière lequel se réfugie la pensée la plus réactionnaire, où se forment des alliances monstrueuses et impensables.(...) Au nom de quoi ? de l'homme! Qui oserait dire du mal de l'homme ! Or, l'effort qui est fait actuellement par les gens de notre. génération, ça n'est pas de revendiquer l'homme contre le savoir et contre la technique, mais c'est précisément de montrer que notre pensée, notre vie, notre manière d'être, jusqu'à notre manière d'être la plus quotidienne, font partie de la même organisation systématique et donc relèvent des mêmes catégories que le monde scientifique et technique. C'est le " cœur humain" qui est abstrait, et c'est notre recherche, qui veut lier l'homme à sa science, à ses découvertes, à son monde, qui est concrète.
" En somme c'est un travail politique : et l'étude du pouvoir que Foucault ne va cesser de conduire à travers l'histoire de la folie et celle des prisons, va le placer au centre des luttes de son époque.
Au préalable deux remarques. D'une part, attention toutefois à ne pas se méprendre : comme il l'écrit lui -même : " Ce n'est donc pas le pouvoir, mais le sujet, qui constitue le thème général de mes recherches. " (" Le sujet et le pouvoir", in Dits et écrits, vol. 4, texte n°306). Foucault travaille à produire une histoire des modes de subjectivation, c'est-à-dire des processsus par lesquels un sujet se constitue. Qu'est-ce qui vous a fait devenir vous-mêmes, à la date d'aujourd'hui, partant du bébé que vous étiez il y a vingt ou soixante ans ? Comment vous êtes-vous construit, et qu'est-ce qui vous construit encore ?
D'autre part, ajoutons d'ores et déjà que chez Foucault " Nietzsche nous sert de lumière " (Les mots et les choses) : ce n'est donc pas un récit historique partant d'une origine pour avancer en toute continuité vers un sujet construit d'un bloc qui est à rechercher. Le travail se veut généalogique c'est-à-dire qu'il part " de la diversité et de la dispersion, du hasard des commencements et des accidents : en aucun cas (la généalogie ne prétend remonter le temps pour rétablir la continuité de l'histoire, mais elle cherche au contraire à restituer les événements dans leur singularité. " ( " Généalogie " in Le vocabulaire de Foucault, J. Revel, Ellipses). La généalogie " dégagera de la contingence ce qui nous a fait être ce que nous sommes, la possibilité de ne plus être, faire ou penser ce que nous sommes, faisons ou pensons. " (Foucault, Qu'est ce que les Lumières, cité par J. Revel)
Folie et déraison : Histoire de la folie à l'âge classique met en scène " le tour par lequel les hommes dans un geste de (la) raison souveraine, enferme leur voisin. " ( Préface, Histoire de la folie...) Car Foucault identifie d'abord un geste constitutif qui partage la folie et la raison, puis montre que la science ne produit un discours sur la folie qu'ensuite, " dans le calme revenu ". Chez les Grecs la folie représente une menace d'Hubris, de démesure ; au Moyen-âge et à la Renaissance, la folie est la trace du débat entre l'homme et les puissances du monde (la Bête, la métamorphose, la Sorcière...) Elle est " carcasse de nuit ". Avec la création de l'Hôpital général en 1656 commence le grand renfermement des pauvres. La période de silence durera 150 ans, jusqu'à la " libération des enchaînes de Bicètre " par Pinel (1745-1826) qui abolit les méthodes thérapeutiques brutales auxquels étaient soumis les aliénés : c'est la naissance de l'asile moderne qui poursuit toutefois la maîtrise des voix de la déraison. Celle-ci se réfugie chez les poètes qui, de Nerval à Artaud, lance une " grande protestation lyrique ", " effort pour redonner à l'expérience de la folie une profondeur et un pouvoir de révélation qui avaient été anéantis par l'internement " ( Préface, Histoire de la folie...). La folie est circonscrite par la raison qui entend s'expurger de ce qui n'est pas elle. Là où raison et déraison étaient jusque-là mêlées, le combat qui commence est celui d'une raison qui entend triompher d'une déraison qu'elle va peu à peu soumettre et dominer (voir à ce sujet Maurice Molho, Pourquoi / De quoi don Quichotte est-il fou ? )
De cette rapide présentation, nous pouvons avancer un des apports de la généalogie : elle entend montrer pourquoi et comment les choses ont pu se constituer ainsi. Et partant, que tout ce qui est historiquement construit, peut être politiquement détruit.
Foucault utilise la même méthode dans son travail sur les prisons, Surveiller et punir, et dans la Volonté de savoir, premier tome de son Histoire de la sexualité. Le premier ouvrage s'interroge sur l'institution prison, en partant toujours du principe que l'emprisonnement n'est pas une pratique intemporelle, il dérive d'un choix qu'il convient d'expliciter. Comme l'explique Foucault dans son cours au Collège de France de 1972-73, intitulé " La société punitive ", la prison propose au XIXème siècle une nouvelle optique (c'est un organe de surveillance généralisée et constante, sur le modèle du panoptique de Bentham), une nouvelle mécanique (discipline de la vie, du temps et des énergies) et une nouvelle physiologie (normes et rejet de ce qui est anormal). Mais pourquoi un tel dispositif, très vite et toujours décrié ? " La prison a l'avantage de produire de la délinquance, un instrument de contrôle et de pression sur l'illégalisme, pièce non négligeable dans l'exercice du pouvoir sur les corps. " La prison, fabrique de délinquants ? Il n'est pas difficile de sentir à quel point la thèse est à la fois forte et explosive.
Foucault élargit sa réflexion sur le pouvoir avec la sexualité, comme ensemble des pratiques, discours, institutions, regards, acteurs qui circulent autour de la production et de l'échange des plaisirs. "La sexualité a été inventée, cette sexualité que nous croyons découvrir en nous-mêmes comme le secret de notre existence ", ce trésor personnel qu'il conviendrait de dévoiler dans la confession ou l'analyse afin de savoir qui nous sommes vraiment. Or, cette sexualité n'a rien d'un secret enfoui : elle résulte de dominations millénaires qui se rejouent dans chacun de nos actes, lors même que nous n'en avons pas conscience et que nous la croyons fondée dans un arrière-plan intelligible inaccessible. Il suffit d'arrêter de jouer la domination hétérosexuelle pour qu'elle stoppe : les luttes peuvent renverser un rapport de pouvoir. Car pour qu'il y ait pouvoir, il faut qu'il y ait liberté. Et là où il y a liberté, existe une possibilité de résistance. Nous reviendrons dans un troisième temps sur un point fondamental de l'Histoire de la sexualité : la modernité plie la sexualité à la question de l'identité. Dis-moi quelle est ta vie sexuelle, je te dirai qui tu es. Or Foucault renverse la problématique : est-il possible de construire un rapport à la sexualité qui ne soit pas un rapport à l'identité, mais une pratique de la liberté ? "Je voudrais montrer comment dans l'Antiquité, l'activité et les plaisirs sexuels ont été problématisés à travers des pratiques de soi, faisant jouer les critères d'une " esthétique de l'existence ". (Foucault, Histoire de la sexualité, t.2, L'usage des plaisirs, " Modifications ")
Revenons sur la question du pouvoir avec un deuxième texte. La sexualité est le point de jonction entre l'individu et la population, deux niveaux où se joue la constitution du sujet, autrement dit l’assujettissement des individus.
L'homme occidental apprend peu à peu ce que c'est d'être une espèce vivante dans un monde vivant, d'avoir un corps, des conditions d'existence, des probabilités de vie, une santé individuelle et collective, des forces qu'on peut modifier et un espace où l'on peut les répartir de façon optimale. Pour la première fois sans doute dans l'histoire, le biologique se réfléchit dans le politique ; le fait de vivre n'est plus ce soubassement inaccessible qui n'émerge que de temps en temps, dans le hasard de la mort et sa fatalité ; il passe pour une part dans le champ de contrôle de l'intervention du pouvoir.
Celui-ci n'aura plus seulement affaire à des sujets de droit sur lesquels la prise ultime est la mort, mais à des êtres vivants, et la prise qu'il pourra exercer sur eux devra se placer au niveau de la vie même. (...) Si on peut appeler biohistoire les pressions par lesquelles les mouvements de la vie et les processus de l'histoire interfèrent les uns avec les autres, il faudra parler de " biopolitique " pour désigner ce qui fait entrer la vie et ses mécanismes dans le domaine des calculs explicites et fait du pouvoir-savoir un agent de transformation de la vie humaine ; ce n'est point que la vie ait été exhaustivement intégrée à des techniques qui la dominent et qui la gèrent ; sans cesse elle leur échappe. Hors du monde occidental, la famine existe, à une échelle plus importante que jamais ; et les risques biologiques encourus par l'espèce sont peut-être plus grands, plus graves tout cas, qu'avant la naissance de la micro-biologie.
Mais ce qu'on pourrait appeler le " seuil de modernité biologique" d'une société, se situe au moment où l'espèce entre comme enjeu dans ses propres stratégies politiques. L'homme, pendant des millénaires est resté ce qu'il était pour Aristote : un animal vivant de plus capable existence politique ; l'homme moderne est un animal vivant de plus capable d'une existence politique ; l'homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d'être vivant est en question. (Michel Foucault, Histoire de la sexualité, t.1, La volonté de savoir, Paris, 1976, Gallimard, pp. 187-188)
Foucault s'attaque à la conception souverainiste du pouvoir qui cherchait à définir qui détenait la souveraineté et pourquoi. Il renverse ce schéma d'un pouvoir vertical, monolithique qui donnerait des ordres d'en haut, pour proposer l'image de micropouvoirs travaillant par capillarité. " À partir du moment où l'on a eu besoin d'un pouvoir infiniment moins brutal et moins dispendieux, moins visible et moins pesant que cette grande administration monarchique, on a accordé à une certaine classe sociale, du moins à ses représentants, des latitudes plus grandes dans la participation au pouvoir et à l'élaboration des décisions. Mais, en même temps, et pour compenser cela, on a mis au point tout un système de dressage en direction essentiellement des autres classes sociales, en direction aussi de la nouvelle classe dominante - car la bourgeoisie a, en quelque sorte, travaillé sur elle-même, elle a élaboré son propre type d'individus. Je ne crois pas que les deux phénomènes soient contradictoires : l'un a été le prix de l'autre ; l'un n'était possible que par l'autre. Pour qu'un certain libéralisme bourgeois ait été possible au niveau des institutions, il a fallu, au niveau de ce que j'appelle les micropouvoirs, un investissement beaucoup plus serré des individus, il a fallu organiser le quadrillage des corps et des comportements. La discipline, c'est l'envers de la démocratie. " (
Les Nouvelles littéraires, 17-23 mars 1975, p. 3.
Dits et écrits vol. 2, texte n°152)
Des individus libres, oui, mais dressés, par une multitude de centres de pouvoirs : la famille, l'école, l'entreprise, et même tous les petits chefs que nous pouvons représenter les uns pour les autres à partir du moment où nous sommes dans un rapport aux autres. La première accommodation qui sous-tend le passage de la loi à la norme porte sur le corps, « dans le corps et avec le corps », objet de disciplines, produites par les institutions. La seconde accommodation porte sur le biologique au sein des populations. Qu'apporte le concept de biopolitique, décliné depuis en biopouvoirs ou bioéthique ? Il désigne l'implication des individus dans des politiques de natalité, d'éducation, de santé, de nutrition, de justice, parce qu'ils font partie d'une population et que cette population vivante donne prise à une pression du politique. Le gouvernement se fait désormais par le contrôle et par la norme. Cette biopolitique implique des organes de centralisation d’où émanent des mécanismes régulateurs.
Le biopouvoir prend la vie en charge, à travers le corps et la population. Foucault entend également sortir d’une conception répandue du pouvoir comme l’instance qui réprime. C’est ce qu’il nomme l’hypothèse Reich (de Wilhem Reich, penseur freudo-marxiste qui conditionnait la libération de l’individu à la levée de la répression libidinale organisée par la société). Dans son
Cours au collège de France, "Il faut défendre la société", Foucault examine l’hypothèse Nietzsche qu’il formule ainsi : «
la guerre, c’est la politique continuée par d’autres moyens ». Cette formule est le retournement de celle de Clausewitz, stratège autrichien repris par Lénine (puis étudié par Raymond Aron dans son
Penser la guerre : Clausewitz) : « la politique, c’est la guerre continuée par d’autres moyens ». Selon la conception classique, hobbesienne, pour sortir de l’état de guerre de tous contre tous, les individus confient leur souveraineté à l’Etat qui garantit ainsi la paix. Le pouvoir est pensé en termes de contrat. Dans l’hypothèse proposée par Foucault, il se pense comme affrontement. La guerre ne s’arrête jamais : elle est perpétuelle, lorsque la politique arrête la guerre elle perdure, silencieuse, dans les institutions, le corps des uns et des autres. Ainsi l’histoire des vainqueurs raconte la guerre, puis la paix, tandis que les vaincus professent des contre-histoires où les batailles et les luttes ne sont jamais achevées. La fin de la guerre serait la fin du politique. Seul l’avènement de l’Etat moderne a pu laisser croire à une politique pacifiée. En réalité, prendre conscience de la persistance de la guerre oblige à cesser de justifier l’Etat au nom de la fin de la guerre. Exactement comme nous justifions l’Union européenne par la paix régnant à l’intérieur des frontières de l’UE. Si pour Foucault la crise n’existe pas, car elle n’est qu’un mot vain reflétant l’incapacité des intellectuels à penser la réalité (voir
Entretiens avec BHL en 1971, in
Dits et écrits, vol. 1, texte n°148) la guerre est bel et bien réelle : «
Il n’y a pas une crise dont il faudrait sortir, il y a une guerre qu’il nous faut gagner », arguent les auteurs du Comité invisible dans
A nos amis, en bons foucaldiens.
Si le pouvoir n’est pas pure répression c’est aussi parce qu’il est gouvernement, entendu comme « ensemble des institutions et pratiques à travers lesquels on guide les hommes depuis l’administration jusqu’à l’éducation. » (
Dits & Écrits, t.4, p.93). Le gouvernement séduit, incite, persuade dans plusieurs directions : d’une part à travers des mécanismes de pouvoir et d’autre part à travers les réponses qu’il suscite chez l’individu. C’est le concept de gouvernementalité, « rapport de soi à soi » qui va permettre de montrer comment le sujet se gouverne, dans son existence et dans son rapport aux autres. Ce dernier aspect va amener Foucault à s’intéresser à l’Antiquité et aux techniques de soi que l’individu utilise pour se modeler d’abord par nécessité sociale puis au-delà, par souci de soi.


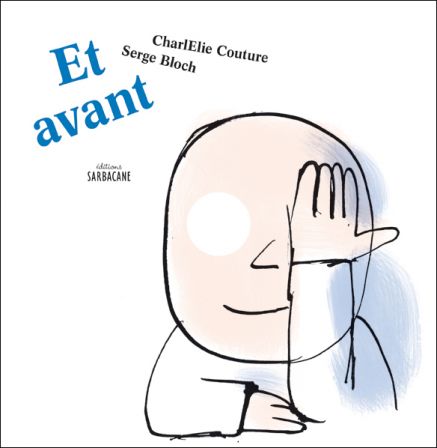



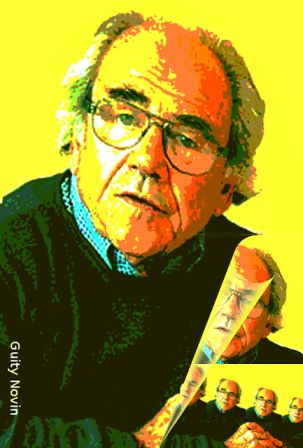


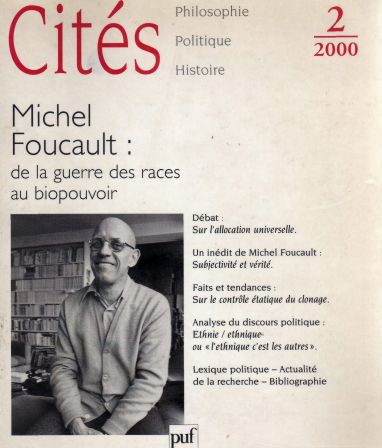 Excellent numéro de la revue Cités consacré à Foucault.
Excellent numéro de la revue Cités consacré à Foucault.
