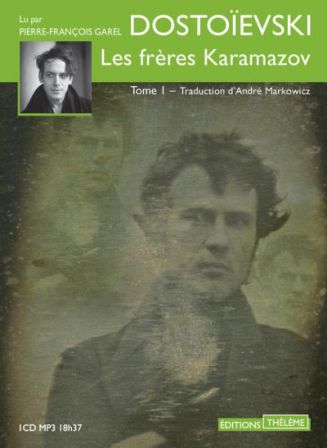Georg Grosz, Automates républicains
Le sommeil de la raison engendre t-il des monstres ?
Pour répondre à la question centrale du colloque organisé par l'ACCHLA, il nous faudra préciser quelle forme
de la raison est en sommeil et quels monstres si monstres il y a, quels
monstres naissent de ce sommeil.
Nous nous proposons de réfléchir en nous axant sur la question des
rapports entre pensée et langage. Définissons d’ores et déjà le mot
langage :
Selon Littré : « tout ce qui sert à exprimer les sensations et les idées ».
Aldous Huxley propose une définition plus riche : « Les mots
constituent le fil sur lequel nous enfilons les résultats de notre
expérience« . Ainsi on ne peut séparer les mots et la pensée.
La pensée ne peut former des représentations que dans les mots : c’est
ce qu’explique Hegel quand il écrit dans la Phénoménologie de l’esprit : « L’intelligence, en se remplissant de mots, se remplit aussi de la nature de choses ».
La langue est un fait social, au sein d’une réalité extérieure,
contraignante, coercitive, qui sous-tend des modes de vie spécifique.
Les langues ne sont pas des nomenclatures, des catalogues de mots
correspondant à des choses. Comme je parle je pense ou comme le disent
Barbara Cassin « chaque langue est un filet qui pêche un certain monde »
et Aldous Huxley : « Words can be like X-rays if you use them properly –
they’ll go through anything. You read and you’re peirced » (les mots
sont comme des rayons X si on les utilise de manière appropriée : ils
traversent tout, on lit et on est traversé)
Partons de cette phrase de Georges Orwell, tirée de son roman 1984 : « la condition mentale dominante doit être la folie dirigée ».
Qu’est-ce qu’une folie ? C’est un mot « interrogatif de part en part » explique Maurice Blanchot. Il met en question la possibilité même du langage.
Selon le Vocabulaire européen des philosophies, la folie, la mania grecque, vient du sanscrit mainomai, qui signifie croire, penser. La folie est donc une pensée, qui peut être considérée de manière duale :
- comme une entité à part entière, un état d’exception :
une pensée délirante (d’un point de vue poétique, divinatoire, érotique), une pensée furieuse au sens de furor,
qui nous emporte, qui nous aveugle complètement comme Ajax qui devient
fou devant le jugement des armes qui attribue les armes de son ami
Achille à Ulysse : il massacre le bétail des Grecs et se suicide.
- comme un état privatif :
- une pensée déraisonnable
- une pensée morbide au sens de malade (morbos), la maladie de l’âme, domaine du philosophe par opposition au corps domaine du médecin.)
- une pensée insane : d’insanitas, faiblesse de
l’intelligence, de l’esprit malade frénétique, marqué par l’égarement et
la violence, qui porte le sujet à rire là où il devrait pleurer
- une pensée démente, qui touche l’individu comme la société selon
Sénèque : « comme l’individu, la communauté sociale est en démence ».
La communauté sociale présente au Moyen-Age différentes figures du fou.
Le fol, sot, forcené, « insipiens » : terme qui vient de sapio,
avoir du discernement, le fol est celui qui n’a pas de discernement.
Une pensée insensée (contraire du bon sens » : celui qui rit dans son
cœur ce qui ne peut pas être pensé. Septante : « l’insensé a dit dans
son cœur : pas de Dieu. » Dans une société devenue chrétienne, le fol
signifie l’incroyant. Le fou est celui qui pense ce que sa communauté ne
peut pas penser.
Se retrouve chez Saint-Paul le geste du renversement qui prend tout
son sens chez Erasme comme à notre époque : « Si quelqu’un parmi vous
croit être sage à la façon du monde, qu’il se fasse fou » ou bien
« nous, nous sommes fous à causes du Christ ». Où est la folie ? Dans le
monde ou dans le fou ? La réalité a deux faces : une glorieuse qui
s’avère toute vanité, une méprisée qui est en définitive la plus sage.
Ce paradoxe vient du fait que la folie est une pensée qui sort des
chaînes de la raison, des normes sociales, de l’équilibre de la santé
qui permet de respecter les obligations sociales.
Quand celles-ci deviennent incohérentes, voire insupportables,
certains comme les Romantiques revendiquent « le droit à la folie », le
fou devient une créature d’élection qui vit selon Charles Nodier
« d’invention, de fantaisie et d’amour dans les pures régions de
l’intelligence ».
Que serait une folie dirigée ? Par définition elle est collective,
assujettie à une puissance extérieure qui dirige l’individu de
l’intérieur. Une sorte d’état de folie imposée par la neutralisation de
la capacité de penser. Par quels stratagèmes pouvons-nous être dirigés
de l’extérieur à l’intérieur ? Par le langage, puissance sociale qui
conditionne notre vie intime.
C’est pourquoi nous partirons d’abord de la langue pour essayer
d’établir un état des lieux avant d’entrer dans les dystopies
contemporaines qui mettent en scène le langage aux prises avec
différents prédateurs.
Le gâteau langagier
Cette expression frappante est forgée par Ivan Illich, penseur prolixe qui prononce en 1978 une conférence intitulée La langue maternelle enseignée.
Il explique comment les mots sont devenus des valeurs marchandes : il
faut investir de l’argent pour décider ce qui sera dit, de quelle
façon, quand et à destination de qui. Il faut investir de l’argent pour
faire « parler les pauvres à la manière des riches ». Il faut investir
de l’argent pour enseigner des jargons professionnels à l’université, et
suffisamment de jargons professionnels au lycée pour que les lycéens
soient tributaires des différents professionnels dans leur vie
quotidienne.
Cette approche provocatrice à première vue est en fait le fruit d’une
des analyses centrales de l’œuvre d’Ivan Illich et qui porte sur la
distinction entre culture traditionnelle et société industrielle.
Toute culture traditionnelle jouit du soleil et des langues
vernaculaires. Le langage est tiré de l’environnement culturel grâce à
la fréquentation des autres membres de chaque culture.
« Mon ami l’orfèvre de Tombouctou s’exprime chez lui en songhaï,
écoute à la radio les émissions en bambara, dit précisément ses cinq
prières en arabe et en comprend le sens, mène ses transactions au souk
en deux sabirs, converse en un français acceptable qu’il a acquis sous
les drapeaux et personne ne lui a jamais enseigné aucune de ces
langues » raconte Illich.
Comme certains villages ont un site favorable sur une rivière,
certains emploient une langue enseignée pour en tirer avantage : les
prêtres utilisent le latin ou le sanskrit etc. Mais cela n’a que peu
d’incidences sur le parler vernaculaire.
Précisons le sens de vernaculaire : latin vernaculum, né,
élevé, tissé, confectionné la maison. C’est un terme utilisé par Varron,
érudit chargé par César de constituer la première bibliothèque publique
de Rome : le langage que le parleur utilise sur son propre terrain,
opposé de ce qui est cultivé ailleurs. Les activités vernaculaires ne
sont pas motivées par des considérations d’échanges. Ce sont des
activités hors marché.
Par opposition, dans une société industrielle, l’enseignement de la
langue maternelle dépend d’enseignants tout comme la chaleur dépend
d’énergie fossile. Les besoins primordiaux sont dépendants de sources
extérieures au foyer. Le langage quotidien est uniformisé « celui du
présentateur qui dévide l’annonce préparée par un rédacteur sur les
indications d’un publicitaire transmettant ce qu’un conseil
d’administration a lui-même décider qu’il fallait dire. »
Ce langage est perturbé par l’incidence de robots dans les échanges,
qui reprennent des formules robotisées, des clichés, des expressions
acquises auprès de locuteurs qui ont pour métier « de pérorer ».
On apprend une langue vernaculaire de vive voix, comme l’enfant est
allaité au sein plutôt qu’au biberon, nous dit Illich, comme je parcours
un km à pied plutôt que dans un véhicule rapide (Illich place la limite
à la bicyclette, véhicule qui permet encore d’habiter un monde), comme
je mange un plat que j’ai cuisiné moi-même plutôt qu’un plateau-repas
industriel.
D’un côté la valeur est déterminée par celui qui l’a crée, de l’autre
le besoin est déterminé par le producteur qui en définit la valeur à
l’intention du consommateur. Les besoins fondamentaux correspondent à
des fournitures marchandes auxquelles on applique des technologies.
« Ce qui fait le monde moderne c’est le remplacement du vernaculaire
par la marchandise, laquelle pour être attirante, doit nier la valeur
essentielle de cet aspect créateur ; une valeur qui échappe à son
possesseur. »
« Les besoins ne sont plus des moteurs qui orientent une action
créatrice mais des manques exigeant l’intervention de professionnels
pour synthétiser la demande. (…) Les besoins deviennent illimités, les
gens de plus en plus avides. » La satisfaction n’est plus de mise ; on
obtient tout au plus des consommateurs consommant « une acceptation
maussade ».
Pour Illich, ce phénomène de « transformation radicale des appétits
individuels entraînée par l’industrialisation » est « le complément
caché de la volonté de dominer la nature ».
En ceci il n’est pas cause de l’essor du capitalisme mais son
symptôme. On trouve en 1978, date de la conférence d’Illich, le même
phénomène dans les dictatures dites socialistes.
Illich l’historien remonte à l’époque carolingienne, pour découvrir
un changement de nature symbolique. C’est à cette époque
« qu’apparaissent des besoins fondamentaux, universels, au genre humain,
et qu’il faut satisfaire de façon uniforme », c’est-à-dire non
vernaculaire. L’individu, la famille et la communauté sont pris en
charge par l’ecclésiastique, vue comme un précurseur des professionnels
des services. Le clergé définit ses services comme répondant à des
besoins de la nature humaine. Dispenser ses services est indispensable
pour que l’individu parvienne au salut. (L’Etat-providence peut être
ainsi pensé comme l’ultime prise en charge pastorale).
Illich établit un parallèle avec l’évolution de la langue, en trois étapes :
- Apparition de l’expression langue maternelle et tutelle monacale sur le parler vernaculaire
Chaque langue vernaculaire est un sermo, la langue du père (patrius sermo), la langue du peuple (sermo vulgaris).
Au XIème siècle, l’Abbaye de Gorze (Metz) devient un centre de réforme
monastique important, concurrent de Cluny, situé à la frontière entre le
roman et le francique. Les moines font de la langue un enjeu et élèvent
le francique au rang de langue maternelle qu’on peut honorer et
défendre comme la maternité aliénée en tombant sous la mainmise du
clergé.
- Transformation des langues maternelles en langues nationales par les grammairiens
Une nouvelle race de clercs utilise la langue comme matière première
d’une entreprise normative. 1492 : première grammaire européenne (hors
latin et grec) : le castillan que Nebrija dédie à Isabelle la
catholique. Celle-ci déclare que la langue vernaculaire ne peut pas être
enseignée. Nebrija propose de relier la langue à l’empire, « les
lettres aux armes », de faire du castillan un appareil, artificio,
que le vainqueur apporte au Nouveau monde. Alphonse X est le premier à
utiliser la langue vernaculaire à la place du latin, la grammaire va
gouverner la parole.
- Remplacement de la langue usuelle uniformisée enseignée sur la base
de textes écrits par notre idiome contemporain, peu substantiel et
financiarisé.
Illich refuse d’être enseignant, éducateur, « dont la tâche consiste à
former des producteurs de langage en les équipant d’un stock
linguistique. »
Les Hauts-Parleurs, ou la confiscation de la parole publique
L’analyse d’Illich peut trouver illustration dans l’œuvre d’un
écrivain français contemporain : Alain Damasio. Etudions la nouvelle les
Hauts-Parleurs, dans le recueil Aucun souvenir n’est assez solide paru en 2012.
Dans le monde décrit une certaine firme s’empare du mot Orange : on
est en 1993, et l’indifférence est générale. Le 12 septembre 2001, la
loi Sharuh est promulguée dans le secret par l’OMC : elle entérine la
libéralisation des mots.
En 2005 la totalité du lexique des langues est soumis la législation
des noms de marques. L’amendement Jové limite le versement de royalties à
la seule utilisation publique des mots. Les humains vivent avec 200
mots en moyenne ; le plus cher : free, utilisé à toutes les sauces.
« Vive la liberté proclame en ce moment les affiches d’un certain
opérateur, réduisant la liberté à l’accélération d’une technologie.
C’est un monde où tout est susceptible d’être privatisé : le temps
qu’il fait est programmé par la Weather Compagny. Les animaux vrais sont
en passe de disparaître, remplacées par des clones produits par des
firmes.
Dans ce monde vit Clovis Spassky, « révolté du langage, haut-parleur
fabuleux, rhéteur fou ». Il a ramené d’Afrique un « chat vrai », dont il
s’est pris d’affection. Mais voici qu’un jour le découvre agonisant, un
jour victime d’une grêle rouge, pluie acide qui provient de nappes
chimiques utilisées par la Weather pour favoriser la neige d’hiver aux
Rocheuses. Débute alors la folie de Spassky « à travers l’écriture et le
cri », un homme pris de fureur devant l’extermination des chats par les
firmes et la privatisation du langage. Une folie qui le mène à une
révolte plus profonde que celle qu’il croyait déjà vivre, lui qui habite
l’Altermonde, zone où l’on promeut « une autre mondialisation fondée
sur l’échange intense des différences » et où interviennent les
Hauts-Parleurs, qui pratiquent la libre parole publique : c’est un art
difficile, avertit l’un d’eux, « un art dangereux, elle est parfois
indissociable de la propagande, parfois elle s’avère pire qu’elle : un
cri pathétique, ton mal-être vomi en pluie, à des milliers de gens qui
n’ont pas besoin de ça ». Dans un monde où tout mot « copyrighté » est
facturé, Spassky décide de prendre la parole en choisissant un style où
il travaille sur un seul mot et ses dérivés. Ce mot, c’est le son cha.
Spassky se met à glaner des mots qu’il récupère, monnaie, échange
« entre-chat, » « chatonsky », « chacunière » jusqu’à ce retrouve piégé
par les firmes, appâté par un « sémantiquaireé qui vend une partie du
vocabulaire de Mallarmé, et le magnifique « Nonchaloir. »
La dernière tirade de Spassky retransmise sur tous les écrans du monde lui coûtera 17 millions de royalties.
Le discours provoque des émeutes : les Haut-Parleurs quittent la zone
17 pour devenir nomade « pour insinuer des poches d’air, une sorte de
dehors au cœur même du système clos officiel où tout est catalogué et
payant. »
La cible du capitalisme est le singulier, l’irreproductible. Le
rapport au monde y est la capture, la captation, la prédation. Reprenant
l’analyse de Deleuze et Guattari (voir la Postface de Systar dans l’éd. 2015),
Alain Damasio met en scène le décodage intégral de tous les flux
(langage, désir, capitaux…) puis leur recodage dans une nouvelle
circulation. Le capitalisme arrache les mots à leur ancien système de
codage, tel le mot libre, pour les faire circuler comme des flux
marchands dans lesquels ils n’ont plus le même sens. « Les mots n’ont
pas disparu mais ils sont pris à rebours, vidés de leur sens » explique
Marie-José Mondzain.
Le pont est lancé vers Orwell et son novlangue.
Le globish, un novlangue ?
« Orwell avait été frappé, dans les régimes totalitaires nazi et
stalinien, de la manière dont on forgeait certains mots à partir
d’autres mots, comme par exemple ‘gestapo’, raconte l’auteur Bernard Gensane dans l’émission Une vie, une oeuvre consacrée à George Orwell en 1997. « Il
disait : quand on forge un mot comme ‘gestapo’, très rapidement, plus
personne ne sait ce que ça veut dire, pas même un Allemand ne sait ce
que ça signifie exactement, police secrète d’Etat. Donc les mots, les
sigles mentent, les sigles cachent la vérité, et il faut choisir les
mots les plus simples possibles […] parce que les mots sont les miroirs
de notre pensée. […] Et donc Orwell a développé cette problématique :
qu’est-ce qu’une langue artificielle ? C’est une langue qui va être
comprise par tout le monde et donc une langue où par définition on va
faire simple. On va faire simple donc on va supprimer des mots. Et
qu’est-ce qu’on va supprimer ? Pas le mot ‘table’, mais éventuellement
le mot ‘guéridon’. On va supprimer les synonymes, les mots qui veulent
dire plus grand ou plus petit, comme ‘guéridon’. Tout ça a mûri pendant
un certain nombre d’années et il a fini par créer ce « newspeak », ce
novlangue. »
« La Révolution sera complète quand le langage sera parfait. Vous
est-il jamais arrivé de penser, Winston, qu’en l’année 2050 au plus
tard, il n’y aura pas un seul être humain vivant capable de comprendre
une conversation comme celle que nous tenons maintenant ?« , demande un des personnages de « 1984 » au héros de l’œuvre, Winston Smith.
Orwell dans son Appendice à 1984, explique que la langue
peut être utilisée dans les deux sens : comme un facteur d’oppression et
comme un vecteur de liberté Dans le premier cas, la langue « est
taillée jusqu’à l’os ».
Le novlangue est composé de quelques centaines de mots, avec des
règles de grammaire tirées du français et du mandarin, en raison de leur
complexité. Il a pour but « non seulement de fournir un mode
d’expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de
l’angsoc [le pouvoir en place dans le roman] mais de rendre impossible
tout autre mode de pensée ».
Réduire le domaine de la pensée est possible en détruisant des idées via la suppression des mots : « chaque réduction était un gain, puisque moins le choix est étendu, moindre est la tentation de réfléchir ».
« Une personne dont l’éducation aurait été faite en novlangue
seulement, ne saurait pas davantage que égal avait un moment eu le sens
secondaire de politiquement égal ou que libre avait un moment signifié
libre politiquement que, par exemple, une personne qui n’aurait jamais
entendu parler d’échecs ne connaîtrait le sens spécial attaché à reine
et à tour. Il y aurait beaucoup de crimes et d’erreurs qu’il serait hors
de son pouvoir de commettre, simplement parce qu’ils n’avaient pas de
nom et étaient par conséquent inimaginables » relève Orwell.
Parler de choses et d’autres n’a rien de dangereux, tant que
l’individu est capable de former des jugements : la capacité à former un
jugement, qui nécessite un vocabulaire, une précision, des distinctions
sémantiques détruites dans le novlangue. Il faut ajouter que le
novlangue part d’une langue, l’ancilangue, qui est détruite, désossée.
Tous les grands auteurs sont “traduits” en novlangue, dans des volumes
réduits, épurés, adaptés !
Peut-on rapprocher le novlangue du globish, cet anglais qui n’en est
pas un, qui est devenu la langue de l’Europe, comme l’explique Barbara
Cassin ? Pour obtenir des financements, les chercheurs européens doivent
“formater” ce qu’ils ont à dire, regrette la philosophe, “dans des mots
absolument inadéquats, dans des cases qui induisent le vide.” A la
traduction, “langue du monde”, le global english préfère la traduction
assistée par ordinateur.
La “folie quantitative” contre la poéticité du monde
Cette folie dirigée prend appui en effet en notre début de XXIème
siècle, sur les chiffres, le calcul, les algorithmes, au point qu’on
peut parler de folie quantitative. « C’est le règne de la règle.
Celle-ci ne s’encombre pas de principes ou de généralités. Elle
accumule les chiffres (jamais élevés à la dignité du nombre qui seul
fait calcul), fait série, a réponse non pas à tout mais à chaque cas.
(…) Elle asservit les peuples. Nous pouvons la désigner d’un terme
classique : folie totalitaire – folie quantitative » écrit le
psychanalyste Hervé Castanet.
Le règne de l’algorithme est avant tout celui de grandes firmes dont
la mission consiste, relève Barbara Cassin, à “organiser toute
l’information mondiale”. Il ne s’agit pas d’une entreprise culturelle
note la philosophe mais d’une entreprise de classement par l’opinion
d’informations. Une “opinion au carré”, puisque plus une information est
retenue plus elle remonte dans la liste sans autre critère que cette
popularité.
Évidemment la question de la vérité devient cruciale à une époque où,
comme le 22 janvier 2017, le directeur de la communication de la
Maison-Blanche, Sean Spicerse flattait que la foule venue acclamé Donald
Trump était « la plus importante à avoir jamais assisté à une investiture dans le monde. Point barre« .
La conseillère de Donald Trump Kellyanne Conway est ensuite intervenue
pour soutenir cette affirmation contestée en assurant qu’il avançait des
« faits alternatifs » afin de contrecarrer les « choses fausses » avancées par les médias… Qu’est-ce qu’un discours qui abandonne toute prétention à la vérité ?
Parallèlement à cette problématique, notons que dans son Retour au meilleur des mondes,
en 1958, Aldous Huxley pointe qu’« en un mot, l’information des masses
n’est ni bonne, ni mauvaise, c’est simplement une force comme n’importe
quelle autre, elle peut être bien ou mal employée. » « Il y a aussi le
développement d’une immense industrie de l’information ne s’occupant ni
du vrai ni du faux mais de l’irréel et de l’inconséquent à tous les
degrés. » Huxley dénonce cette « fringale de distraction » devenue le
nouvel opium du peuple.
Gavé d’une nouvelle « morale sociale » qui professe l’ajustement,
l’adaptation, l’intégration et le travail en équipe, ce peuple perd
l’usage du langage. Or apprendre la liberté nécessite d’une part
d’apprendre à reconnaître les méthodes de propagande et se convaincre de
valeurs minimales auxquelles soumettre la propagande rationnelle (celle
que la surpopulation rend nécessaire, dans l’intérêt de tous,
contrairement à la propagande irrationnelle, qui flatte les passions de
chacun) : liberté individuelle, charité et compassion, amour et
intelligence précise Huxley. Il en vient à formuler l’exigence d’un Habeas mentem préventif, protégeant nos esprits d’un abrutissement généralisé.
Cette entreprise d’assèchement de la pensée provoque également
l’évidement des émotions : qu’est-ce qu’une émotion qui ne peut se dire,
qui ne peut se partager ? Comme l’écrit Jean-Luc Nancy « si nous comprenons, si nous accédons d’une manière ou d’une autre à une orée du sens, c’est poétiquement ». Quelle place dans cette folie pour la poésie ?
Le marché n’a pas d’esprit, la poésie n’est pas une marchandise, et
pire que cela, elle ne fait pas vendre. Dans cette lumière apparaît une
vérité essentielle de notre temps : l’omniprésence de la publicité n’est
pas un dommage collatéral que nous supportons sans broncher. Elle est
une des conditions nécessaires à l’acte d’achat. C’est parce que les
oreilles sont occupées dans les magasins par un fond sonore excitant que
les consommateurs consomment. Une simple interruption de ce flot
perturbe déjà l’automatisme. Certains ont intérêt à ce que l’automate
demeure « en mode automatique », expression terrible, répandue, qui
calque les mécanismes de l’esprit sur les fonctionnalités des
ordinateurs.
Bonne nouvelle ? Les mots conservent une puissance majestueuse si
seulement ils sont préservés de toute instrumentalisation, ainsi dans
l’optique poétique. La poésie est une insurrection en soi contre les
marchands.
Rappelons l’invitation de Pier Paolo Pasolini dans Traitement (in la Rage) :
« Que s’est-il passé dans le monde, après la guerre et l’après-guerre ?
La normalité. Oui, la normalité. Dans l’état de normalité, on ne regarde
pas autour de soi : tout autour se présente comme « normal », privé de
l’excitation et l’émotion des années d’urgence. L’homme tend à
s’assoupir dans sa propre normalité, il oublie de réfléchir sur soi,
perd l’habitude de se juger, ne sait plus se demander qui il est. C’est
alors qu’il faut créer, artificiellement, l’état d’urgence : ce sont les
poètes qui s’en chargent. Les poètes, ces éternels indignés, ces
champions de la rage intellectuelle, de la furie philosophie. »
Tels les Hauts-Parleurs d’Alain Damasio, pénétrons la Cité,
promenons-nous sur les places, courons les ruelles, ensemençons les
quais et portons haut les verbes, les adverbes et les noms, les points
d’exclamation, les guillemets polis et crions un langage encore libre et
fécond capable de poéticité : “rencontre de ce qui vient du monde et de
ce que l’homme éprouve” (Kostas Axelos).
Bibliographie non exhaustive
- Ivan Illich, « La langue maternelle enseignée », Oeuvres complètes, vol II, Fayard
- Georges Orwell, « Appendice », 1984, Folio Gallimard, 1950
- Jean-Luc Nancy, « Faire, la Poésie », in Nous avons voué notre vie à des signes, 1976-1996, William Blake & Co. Edit
- Alain Damasio, « Les Hauts® Parleurs® », Aucun souvenir assez solide, Folio SF, 2012
- Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991
- Barbara Cassin, Google-moi : La deuxième mission de l’Amérique, 2012, Editions Albin Michel
- Aldous Huxley, Retour au meilleur des mondes, 1958, 2013, Omnibus
- Pier Paolo Pasolini, « Traitement », in La Rage, 2014, Nous
- Hervé Castanet, sous la dir., Quelle liberté pour le sujet à l’époque de la folie quantitative ? 2009, Pleins Feux