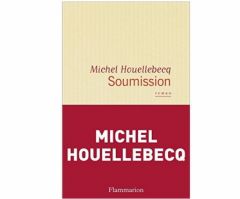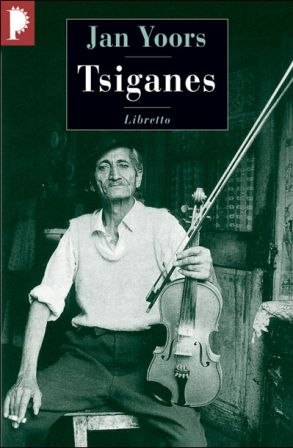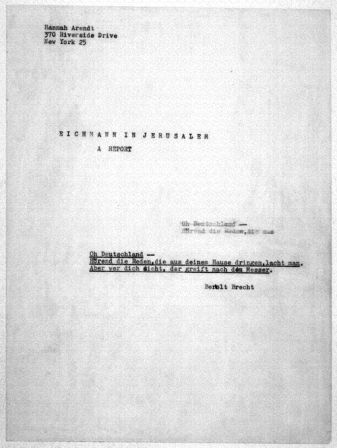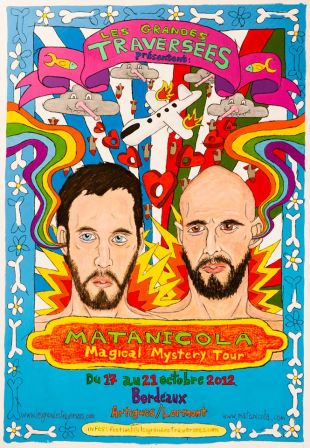"Il doit être près de six heures. J'ai des fourmis dans les jambes. Je me sens atteinte de ce que j'appelais, à cause de Maman Sucre [psychanalyste d'Anna, la narratrice], "le mal de la ménagère". Cette tension en moi, le fait que la torpeur m'ait quittée, est due au retour du courant : Il-faut-que-j'habille-Janet-que-je-l'envoie-à-l'école-que-je-prépare-le-petit-déjeuner-de-Michael-sans-oublier-que-je-n'ai-plus-de-thé, etc. Avec cette tension inutile, mais apparemment inévitable, vient aussi la rancœur. Contre quoi ? Contre une injustice. Contre le fait que je doive perdre tout ce temps à me soucier de détails. La rancœur se dirige contre Michael : je sais pourtant, avec mon intelligence, qu'elle n'a rien à voir avec Michael. Mais je lui en veux quand même, parce qu'il sera toute la journée servi par des secrétaires, des infirmières, des femmes ayant toutes sortes de compétences, qui le libéreront de toutes ces charges. J'essaie de me détendre, de chasser la tension. Mais j'ai mal dans tous mes membres. il faut que je me retourne. Les mouvements reprennent ; de l'autre côté du mur Janet s'éveille. Aussitôt Michael bouge, et je le sens bander contre mes fesses. La rancœur se concentre : évidemment, il choisit le moment où je suis tendue, où je guette Janet. Mais ma colère ne le concerne pas. J'ai appris depuis longtemps, à l'époque de mes séances avec Maman Sucre, que la rancœur et la colère sont impersonnelles. Elles constituent la maladie des femmes de notre temps. Et je l'observe sur le visage des femmes, dans leur voix, chaque jour, dans les lettres qui arrivent au bureau. Ces émotions de femmes : le ressentiment contre l'injustice, véritable poison impersonnel. Les malheureuses qui ne savent pas que c'est impersonnel se retournent contre leurs hommes. Celles qui ont de la chance comme moi, se débattent. C'est une lutte épuisante. Michael me prend de dos, à demi endormi, proche et ardent. il me prend d'une manière impersonnelle, et je ne réponds pas comme je le fais lorsqu'il aime Anna. Mon esprit est ailleurs, j'écoute si les petits pieds légers de Janet [fille de la narratrice] s'approchent, et je me demande comment je pourrai me lever et aller à la porte et l'empêcher d'entrer. Elle n'entre jamais avant sept heures : c'est la règle ; je suis certaine qu'elle n'entrera pas ; mais il faut que je reste sur mes gardes. Tandis que Michael me tient et me pénètre, les bruits continuent dans la pièce à côté, et je sais qu'il les entend aussi ; pour lui, me prendre ainsi au risque d'une intrusion fait partie de son plaisir ; pour lui, cette petite bonne femme de huit ans, Janet, représente en partie les femmes - les autres, celles qu'il trahit pour coucher avec moi ; et en partie l'enfant, l'essence de l'enfant, contre qui il revendique le droit de vivre. (...)
Lorsque nous avons fini, il me dit : "Alors, tu vas m'abandonner pour Janet, je suppose ? " avec une voix de gosse qui se sent délaissé au profit d'un jeune frère. Je ris et l'embrasse : mais le ressentiment m'envahit si violemment que je serre les dents pour ne pas l'exprimer. Je me retiens, comme toujours, en me disant que si j'étais née homme je serais certainement pareille. le contrôle et la discipline que m'impose mon rôle de mère me paraissent si durs que ne puis guère me faire d'illusions : si j'étais un homme sans l'obligation de me contrôler sans cesse, je serais très différente. Pourtant, les quelques instants qu'il me faut pour enfiler un vêtement avant de rejoindre Janet sont chargés d'une fureur empoisonnée. Je me lave rapidement l'entrejambe afin que l'odeur de sexe ne trouble pas Janet, bien qu'elle ne sache pas encore ce que c'est. J'aime cette odeur et je déteste l'obligation de la faire disparaître aussi vite. Cette nécessité accroît ma mauvaise humeur. (Je me souviens d'avoir pensé que le fait d'observer délibérément toutes mes réactions les exacerbait ; normalement, elles ne seraient pas aussi vives). Dès que je referme derrière moi la porte de Janet et que je la vois assise sur son lit, ses cheveux noirs tout ébouriffés et bouclés, avec son petit visage pâle (le mien) souriant, le ressentiment disparaît par habitude et fait presque aussitôt place à la tendresse. Il est six heures et demie ; cette petite chambre est glacée, et la fenêtre ruisselle également d'eau grise. J'allume le radiateur à gaz, tandis qu'elle reste assise sur son lit, au milieu des bandes dessinées multicolores et qu'elle me regarde en lisant, pour voir si je fais chaque chose comme d'habitude. Dans un élan de tendresse, je m'amenuise jusqu'à la dimension de Janet, je deviens Janet. L’énorme feu jaune ressemble à un œil géant ; la fenêtre est si grande qu'il pourrait y entrer n'importe quoi. La lueur inquiétante et grise du jour attend le soleil, ange ou diable, qui chassera la pluie. Puis je redeviens Anna : je vois Janet, petit enfant, dans son grand lit. Un train passe, et fait trembler légèrement les murs. Je traverse la pièce et l'embrasse ; et je sens la délicieuse odeur de sa chair tiède, de ses cheveux, du tissu de son pyjama tout chaud de sommeil. Pendant que sa chambre se réchauffe, je vais à la cuisine lui préparer son petit déjeuner - céréales, œufs brouillés et thé, sur un plateau. Je rapporte le plateau dans sa chambre, et elle prend son petit déjeuner au lit tandis que je bois du thé en fumant. (...)
Il est maintenant près de huit heures ; c'est le début d'une nouvelle pression : aujourd'hui Michael doit aller à l'hôpital du sud de Londres et il doit se réveiller tôt pour arriver à l'heure. il préfère que Janet parte pour l'école avant son réveil. Et moi aussi car cela me partage. Mes deux personnalités - la mère de Janet et la maitresse de Michael, sont plus heureuses séparées. Il m'est pénible d'être toutes les deux à la fois. Il ne pleut pas. J'essuie la buée de respiration nocturne et de transpiration sur la fenêtre et je constate que la journée s’annonce fraîche et humide, mais claire. L'école de Janet est toute proche, on y va facilement à pied. Je lui recommande de prendre son imperméable. Elle proteste aussitôt : "Oh non ! maman, je déteste mon imperméable. Je préfère mon manteau." J'insiste avec une calme fermeté : "Non. Ton imperméable. Il a plu toute la nuit. - Qu'est ce que tu en sais, puisque tu dormais ?" Cette répartie triomphante lui rend sa bonne humeur. Elle va maintenant prendre son imperméable et enfiler ses bottes de caoutchouc sans faire d'histoires. "Est-ce que tu viendras me chercher à l'école cet après-midi ? - Oui je crois. (...) - Si tu ne viens pas me chercher j'irai jouer chez Barbara. - Bon, si tu y vas, je viendrai te chercher à six heures. " Elle dévale l'escalier dans un vacarme épouvantable. (...) Je reste en haut de l'escalier, l'oreille tendue, jusqu'à ce que la pote d'entrée claque, quelques instants plus tard ; puis je chasse le souvenir de Janet pour la durée de notre séparation.
Je retourne dans ma chambre. Michael forme une masse sombre sous les couvertures. Je tire les rideaux à fond, m'assieds sur le lit, et embrasse Michael pour l'éveiller. Il m'agrippe en disant : "Reviens te coucher. - Il est huit heures, dis-je. Après. " Il pose ses mains sur ma poitrine. Comme mes seins brûlent, je réprime ma réaction en répétant : "Il est huit heures. - Oh ! Anna, tu es toujours tellement efficace et organisée, le matin. - Heureusement" dis-je d'un ton léger - mais j'ai senti l'intonation contrariée de sa voix. "Où est Janet ? - Partie pour l'école." Il laisse tomber ses mains, et j'en éprouve une déception - perverse - car nous ne ferons pas l'amour. Un soulagement aussi ; car si nous avions fait l'amour il aurait été en retard et m'en aurait manifesté de la mauvaise humeur. Et bien sûr, une rancœur : mon affliction, mon fardeau, ma croix. De la rancœur, parce qu'il m'a dit : " Tu es toujours tellement efficace et organisée", alors que c'est justement à cause de mon efficacité et de mon organisation qu'il peut passer deux heures de plus au lit."...
Extrait du Carnet d'or, Doris Lessing, Ed. de Poche. pp. 488 à 494.