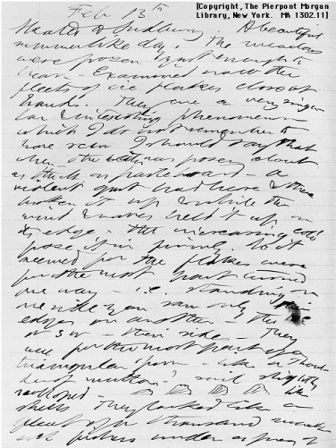Mais pour parler pratiquement et en citoyen, à la différence de ceux qui se baptisent antigouvernementaux, je réclame, non une absence immédiate de gouvernement, mais immédiatement un meilleur gouvernement. Que chacun publie quel serait le genre de gouvernement qu'il respecterait et nous aurions déjà fait un pas vers sa réalisation.
Après tout, la raison pratique pour laquelle, une fois le pouvoir échu aux mains du peuple, une majorité reçoit la permission de régner, et continue de la détenir pour une longue période, ce n'est pas parce qu'elle court plus de risques d'avoir raison, ni parce que cela semble plus juste à la minorité, mais parce qu'elle est physiquement la plus forte. Or le gouvernement où la majorité décide dans tous les cas ne peut se fonder sur la justice, y compris au sens restreint où l'entend l'humanité. Ne peut-il exister un gouvernement dans lequel les majorités ne décident pas virtuellement du juste et de l'injuste, mais bien plutôt la conscience ? - dans lequel les majorités ne décident que de ces questions où la règle de l'utilité est opérante ? Le citoyen doit-il un seul instant, dans quelque mesure que ce soit, abandonner sa conscience au législateur ? Pourquoi, alors, chacun aurait-il une conscience? Je pense que nous devons d'abord être des hommes, des sujets ensuite : le respect de la loi vient après celui du droit. L'obligation que j'aie le droit d'adopter, c'est d'agir à tout moment selon ce qui me paraît juste. On dit justement qu'une corporation n'a pas de conscience; mais une corporation faite d'êtres consciencieux est une corporation douée d'une conscience.
La masse des hommes sert l'État de la sorte, pas en tant qu'hommes, mais comme des machines, avec leurs corps. Ils forment l'armée de métier, ainsi que la milice, les geôliers, policiers, posse comitatus1, etc. Dans la plupart des cas, il n'existe aucun libre exercice du jugement ou du sens moral ; mais ils se mettent au niveau du bois, de la terre et des pierres ; et l'on pourrait réaliser des hommes de bois qui rempliraient aussi bien cette fonction. Ils ne méritent pas plus de respect que des épouvantails ou un étron. Ils ont la même valeur que des chevaux ou des chiens. Pourtant, ce sont de tels êtres qu'on juge communément de bons citoyens. D'autres - comme la plupart des législateurs, politiciens, juristes, ministres ou fonctionnaires - servent l'Etat surtout avec leur tête ; et, comme ils font rarement la moindre distinction morale, ils risquent tout autant de servir le Diable, sans en avoir l'intention, que Dieu. Un tout petit nombre - héros, patriotes, martyrs, réformateurs au sens fort, des hommes enfin, servent l'Etat avec leur conscience aussi et lui résistent nécessairement pour l'essentiel ; et il les traite souvent en ennemis. L'homme sage n'est utile qu'en tant qu'il reste un homme et refusera d'être de la « glaise » ou de « jouer les bouche-trous », et laissera cette mission à sa poussière.
Qui s'offre entièrement à ses congénères leur paraît inutile et égoïste ; celui, en revanche, qui s'offre partiellement est tenu pour un bienfaiteur et un philanthrope.
Quel est le comportement qui s'impose à un homme face à ce gouvernement américain, aujourd'hui ? Je réponds qu'il ne peut sans honte y être associé. Je ne puis un seul instant reconnaître cette organisation politique pour mon gouvernement puisqu'elle est aussi le gouvernement de l'esclave.
Tous les hommes admettent le droit à la révolution ; c'est-à-dire le droit de refuser l'allégeance au gouvernement, et celui de lui résister, quand sa tyrannie ou son inefficacité sont grandes et insupportables. Mais presque tous disent que tel n'est pas le cas, à présent. Mais tel était le cas, estiment-ils, lors de la révolution de 1775. Si l'on devait me dire que le gouvernement de l'époque était mauvais parce qu'il taxait certaines commodités étrangères introduites dans ses ports, il est plus que probable que je ne m'en émeuvrais pas car je puis m'en passer. Toutes les machines connaissent des frictions ; et il se peut que celle-ci soit assez profitable pour contrebalancer le mal. Mais quand la la friction vient à posséder sa machine, que l'oppression et le vol sont organisés, je déclare : refusons de supporter plus longtemps cette machine.
En pratique, les adversaires d'une réforme dans le Massachusetts ne sont pas une centaine de milliers de politiciens dans le Sud, mais une centaine de milliers de marchands et de fermiers ici qui sont plus préoccupés par le commerce et l'agriculture qu'ils ne le sont par l'humain et qui ne sont pas prêts à rendre justice en laveur de l'esclave ou du Mexique, quel qu'en soit le coût. Je ne me querelle pas avec des ennemis éloignés, mais avec ceux qui, près de chez moi, coopèrent avec les premiers et leur obéissent et sans lesquels ils seraient inoffensifs. Nous avons coutume de dire que le gros des hommes ne sont pas préparés ; mais si l'amélioration est lente, c'est parce que le petit nombre n'est pas matériellement plus sage ni meilleur que le grand nombre. Qu'il existe quelque part un bien absolu est plus importantqu'un grand nombre soit aussi bon que vous: car cela fera lever toute la pâte. Des milliers de gens sont opposés en opinion à l'esclavage et à la guerre, mais ils ne font rien, en effet, pour y mettre un terme; ils s'estiment enfants de Washington et de Franklin, et s'asseyent les mains dans les poches en déclarant qu'ils ignorent quoi faire et ne font rien : ils subordonnent même la question de la liberté à celle du libre-échange et lisent tranquillement le cours des prix en même temps que les dernières nouvelles du Mexique après dîner et qui sait, s'assoupissent sur les deux. Quel est le prix courant d'un homme honnête et d'un patriote aujourd'hui ? Ils hésitent, et ils regrettent et parfois ils font des pétitions ; mais ils ne font rien d'ardent et d'efficace. Ils attendent. pleins de bonne volonté, que d autres portent remède au mal, qu'ils n'aient plus à le regretter. Au mieux, ils donnent une voix bon marché, un renfort chétif et un « bon voyage! >, au bon droit quand il passe à leur hauteur. Il y a 999 professeurs de vertu pour un homme vertueux. Mais il est plus commode de traiter avec le véritable possesseur d'une chose qu'avec son gardien temporaire.
Tout vote est une sorte de jeu, comme le jeu de dames ou le backgammon teinté d'une légère nuance morale, un jeu entre le juste et l'injuste, comportant des questions morales : et cela s'accompagne naturellement d'un pari. Le caractère des votants, lui, n'est pas en jeu. Je vote peut-être selon mon idée de la justice; mais que celle-cil'emporte ne me concerne pas dans ma chair. J'accepte de m'en remettre à la majorité. Son obligation, en conséquence, n'excède jamais celle de l'utilité. Même voter pour la justice, ce n'est rien faire pour elle. C'est se contenter d'exprimer un faible désir de la voir prévaloir. Le sage ne laissera pas la justice à la merci du hasard, il ne souhaitera pas la voir remporter par le pouvoir de la majorité. Il y a peu de vertu dans l'action des masses d'hommes. Quand la majorité finira par voler l'abolition de l'esclavage, ce sera parce qu'elle lui sera indifférente ou parce qu'il en restera peu qui soit aboli par ce vote. Ce seront eux les seuls esclaves. La seule voix qui puisse hâter l'abolition de l'esclavage est celle de l'homme qui engage par là sa propre liberté.
J'entends parler d'une convention qui doit se réunir à Baltimore, ou ailleurs, pour choisir un candidat à la présidence, constituée pour l'essentiel d'éditeurs et de politiciens professionnels; mais je me dis, en quoi la décision qu'ils prendront importe-t-elle à un homme indépendant, intelligent et respectable? N'aurons-nous pas l'avantage de sa sagesse et de son honnêteté malgré tout ? Ne pouvons-nous compter sur quelque voix indépendante ? N'y a-t-il pas beaucoup d’individus dans le pays qui n'assistent pas aux conventions ? Mais non : je m'aperçois que l'homme soi-disant respectable a immédiatement quitté sa position, qu'il désespère de son pays quand celui-ci a plus de raisons de désespérer de lui. Il s'empresse d'adopter l'un des candidats ainsi choisi comme le seul disponible, prouvant ainsi qu'il est lui-même disponible pour toutes les visées du démagogue. Sa voix n'a pas plus de valeur que celle de tout étranger sans principes, de tout larbin autochtone qu'on aurait pu acheter. Puissions-nous trouver un homme qui soit un homme, qui, comme dit mon voisin, ait une échine à travers laquelle on ne puisse passer la main ! Nos statistiques sont erronées : la population est surévaluée. Combien y a-t-il d'hommes par millier de milles carrés dans ce| pays ? À peine un. L'Amérique n'offre-t-elle aucun attrait aux colons ? L'Américain s'est rapetissé jusqu'à être un « compagnon » - quelqu'un qu'on reconnaît au développement de ses organes grégaires, à son, manque manifeste d'intellect et d'autonomie enthousiaste ; dont le premier et principal souci, à son entrée dans le monde, est de veiller à ce que l'hospice soit en bon état; et, bien avant; qu'il ait revêtu la toge virile, de réunir des fonds pour l'entretien des veuves et orphelins qui existent; qui, en un mot, se risque à ne vivre que par l'aide de la « Compagnie d'assurance mutuelle » qui a promis de l'inhumer décemment. Le devoir d'un homme n'est pas, en général, de se vouer à l'éradication de la moindre injustice, fût-elle énorme; il lui est loisible d'avoir d'autres sujets d'intérêts ; mais son devoir veut à tout le moins qu'il s'en lave, les mains et, s'il n'y pense pas davantage, qu'il ne lui donne pas son soutien objectif. Si je me consacre à d'autres intérêts ou contemplations, je dois à tout le moins veiller, pour commencer, que je ne les cultive pas assis sur les épaules d'autrui. Je dois en descendre, qu'il puisse poursuivre ses contemplations lui aussi. Songez à l'immense absurdité qu'on tolère ! J'ai entendu certains de mes compagnons déclarer : «J'aimerais les voir m'ordonner d'aider à réprimer une insurrection des esclaves ou de marcher sur Mexico - vous pensez comme j'irais ! » ; pourtant ces hommes-là ont chacun, directement par leur allégeance, et donc indirectement, au moins par leur argent, fourni un remplacement. Ce sont ceux-là mêmes qui ne refusent pas de soutenir le gouvernement injuste dans sa guerre, qui applaudissent le soldat qui refuse de servir dans une guerre injuste ; ils l'applaudissent alors qu'il méprise et anéantit leur acte et leur autorité; comme si l'État se repentait au point de prier quelqu'un de l'étriller lorsqu'il pèche, mais pas assez pour cesser de pécher un seul instant. Ainsi, au nom de l'ordre et du gouvernement civil, on nous oblige finalement à rendre hommage à notre propre pusillanimité et à la soutenir. Après la première rougeur du péché vient l'indifférence ; et d'immoral il devient en quelque sorte amoral et pas tout à fait inutile dans la vie que nous avons créée.
Seule la vertu la plus désintéressée peut soutenir l'erreur la plus ample et la plus répandue. Ce sont surtout les êtres nobles qui s'exposent au léger reproche qu'on peut opposer à la vertu de patriotisme. Ceux qui, tout en critiquant le type et les décisions d'un gouvernement, lui donnent leur allégeance et leur soutien sont assurément ses soutiens les plus scrupuleux et donc souvent les obstacles les plus sérieux à la réforme. Certains demandent à l'Etat de dissoudre l'Union, de ne tenir aucun compte des réquisitions du président. Pourquoi ne la dissolvent-ils pas eux-mêmes, l'union qui existe entre eux et l'État, et ne refusent-ils pas de verser leur quota au Trésor ? Ne sont-ils pas dans la même relation vis-à-vis de l'État que ce dernier vis-à-vis de l'Union ? Et ne sont-ce pas les mêmes raisons qui ont dissuadé l'État de résister à l'Union et les ont dissuadés de résister à l'État ?
Que votre vie devienne un contre-frottement pour arrêter la machine. Ce à quoi je dois veiller, à tout le moins, c'est à ne pas me prêter au mal que je condamne. Je n’hésiterai pas à dire que ceux qui se baptisent abolitionnistes devraient retirer sur-le-champ leur soutien effectif, tant personnel que matériel, au gouvernement du Massachusetts sans attendre qu'ils forment une majorité d'une personne, sans attendre qu'ils permettent au juste de triompher par leur entremise. Je pense qu'il suffit d'avoir Dieu avec soi, sans attendre cette fameuse autre personne. D'ailleurs, tout homme plus juste que ses prochains forme déjà cette majorité d'une personne.
Car il importe aujourd'hui de voir quelle peut être la petitesse des commencements : ce qui est bien fait est fait une fois pour toutes.
Sous un gouvernement qui emprisonne un seul être injustement, la juste place du juste est aussi la prison.
Quand je converse avec les plus libres de mes voisins, je note que, malgré tout ce qu'ils peuvent dire de l'importance et du sérieux de la question, de leur souci de la tranquillité publique, la question se résume à ceci : ils ne peuvent se passer de la protection du gouvernement actuel et redoutent les conséquences de la désobéissance sur leurs biens et leur famille. Pour ma part, je n'aimerais pas à croire que je m'en remets parfois à la protection de l'État. Mais, si je réfute l'autorité de l'Etat lorsqu'il présente sa feuille d'impôts, il ne tardera pas à prendre et à détruire tous mes biens, à me harasser sans fin moi et mes enfants. Cela est chose pénible. Cela interdit à un homme de vivre honnêtement et confortablement à la fois, du point de vue des apparences. Il ne vaudra pas la peine qu'il accumule des biens ; il ne manquerait pas de les perdre. Il faut prendre une location ou un refuge quelque part, cultiver une petite récolte et se hâter de la manger. Il faut vivre en autarcie, ne dépendre que de soi, être toujours prêt à lever le camp sans avoir beaucoup à emporter.
Je n'ai payé aucun impôt local depuis six ans. On m'a mis en prison une fois pour cette raison, une nuit. Et comme je regardais les murs de pierre massive, épais de deux ou trois pieds, la porte de bois et de fer épaisse d'un pied, la grille de fer qui altérait la lumière, je ne pouvais m'empêcher d'être frappé par la stupidité de cette institution qui me traitait comme si je n'étais rien que chair et os, à enfermer. Je m'étonnais qu'elle ait fini par conclure que c'était le meilleur usage qu'elle pouvait faire de moi et qu'elle n'ait jamais songé à profiter de mes services de quelque autre manière. Je voyais bien que s'il y avait un mur de pierres entre moi et mes concitoyens, il y en avait un d'encore plus difficile à escalader ou à percer avant qu'ils puissent être aussi libres que moi. Je ne me sentis pas un seul instant à l'étroit et ces murs paraissaient seulement un vaste gâchis de pierres et de ciment. J'avais l'impression d'être le seul de tous mes concitoyens à avoir payé mes impôts. À l'évidence, ils ne savaient comment me traiter, mais se comportaient comme des gens mal élevés. Chaque menace et chaque compliment dissimulaient une gaffe ; car ils estimaient que mon désir principal était de rester de l'autre côté de ce mur de pierre. Je ne pus m'empêcher de sourire en voyant avec quel soin ils refermaient la porte sur mes méditations, qui les suivaient aussitôt à l'extérieur, sans encombre : c'étaient elles qui étaient dangereuses, en réalité. Comme ils ne pouvaient m'atteindre, ils avaient décidé de châtier mon corps ; tout comme les gamins, s'ils ne peuvent s'en prendre à la personne à qui ils en veulent, injurient son chien. Je voyais que l'Etat était à demi imbécile, qu'il était craintif comme une femme seule pour ses cuillers en argent, qu'il ne pouvait faire la différence entre ses amis et ses ennemis : je perdis le peu de respect que je gardais pour lui et le plaignis.
L'État ne s'adresse donc jamais intentionnellement à la raison de l'homme, intellectuelle ou morale, mais seulement à son corps, à ses sens. Il n'est pas armé d'un esprit ou d'une honnêteté supérieure, mais d'une force physique supérieure. Je ne suis pas né pour être contraint. Je veux respirer comme je l'entends. Voyons donc qui est le plus fort. Quelle force a une multitude ? Seuls peuvent me contraindre ceux qui obéissent à une loi plus altière que la mienne. Ils me contraignent à les imiter. Je n'entends pas parler d'hommes contraints à vivre de telle ou telle manière par des groupes d'hommes. Quelle sorte de vie serait-ce là ? Quand je rencontre un gouvernement qui me dit « La bourse ou la vie », pourquoi me hâterais-je de lui donner mon argent ? Il est peut-être dans une situation très difficile et ne sait que faire : je n'y puis rien. Il faut qu'il s'en sorte tout seul ; qu'il fasse comme moi. Rien ne sert de pleurnicher. Je ne suis pas responsable de la réussite du fonctionnement social. Je ne suis pas le fils de l'ingénieur. J'observe que lorsqu'un gland et une châtaigne tombent l'un à côté de l'autre, l'un d'eux ne reste pas inerte, ne s'efface pas devant l'autre, mais que tous deux obéissent à leurs propres lois, jaillissent, croissent et fleurissent de leur mieux jusqu'à ce que l'un en vienne, d'aventure, à dominer et détruire son rival. Si une plante ne peut vivre selon sa nature, elle meurt ; et il en va de même pour un homme.
Je souhaite seulement refuser mon allégeance à l'État, me retirer et m'en tenir à l'écart en pratique. Peu me chaut de suivre pas à pas mon dollar, si c'est possible, à moins qu'il n'achète un homme ou une arme pour en tuer - le dollar est innocent mais ce qui m'importe c'est de repérer les effets de mon allégeance. En fait, je déclare tranquillement la guerre à l'État, à ma manière, bien que je souhaite continuer d'en retirer les utilités et les avantages que je pourrai, c'est bien naturel.
Si d'autres paient l'impôt qui m'est demandé, par compréhension pour l'État, ils ne font que ce qu'ils ont déjà fait pour eux, ou plutôt ils ajoutent à l'injustice que celui-ci exige. S'ils paient l'impôt par souci mal placé de l'individu imposé, pour sauver ses biens, ou empêcher son internement, c'est pour n'avoir pas considéré avec sagesse combien ils permettent à leurs sentiments personnels de contrarier le bien public.
Il n'y aura jamais d'Etat vraiment libre et éclairé tant qu'il ne reconnaîtra pas l'individu comme un pouvoir plus altier et indépendant, d'où dérivent son propre pouvoir et son autorité, et qu'il ne le traitera pas en conséquence. Il me plaît d'imaginer un Etat qui puisse se permettre d'être juste envers tous les hommes et qui traite l'individu avec respect comme un voisin ; qui ne jugerait pas sa propre quiétude menacée si quelques-uns s'installaient à l'écart, ne s'y mêlant pas, en refusant l'étreinte, sans pour autant s'abstenir de remplir tous les devoirs de bons voisins et de compatriotes. Un Etat qui porterait ce genre de fruit, et le laisserait tomber aussi vite qu'il a mûri, ouvrirait la voie à un Etat encore plus glorieux et parfait, que j'ai également imaginé sans le voir nulle part.
H. D. Thoreau, La désobéissance civile, trad. G. Villeneuve, Ed. Les 1001 nuits, 1996
1Le pouvoir du comté par opp. au pouvoir militaire